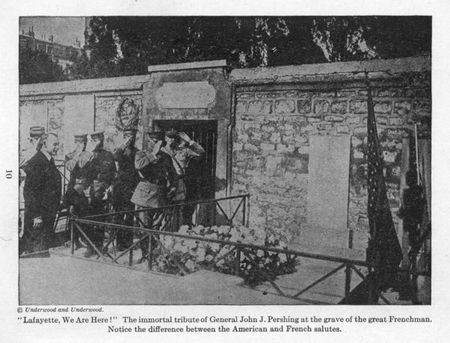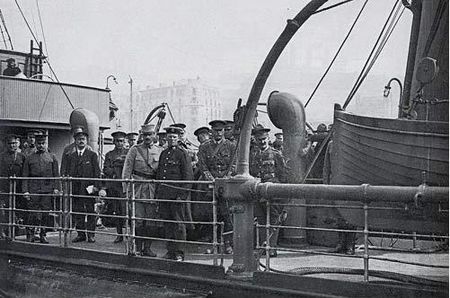La participation des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale est souvent mal connue et mal comprise en France. Lors du vote de la déclaration de guerre officielle, le 6 avril 1917, par le Congrès des États-Unis, ceux-ci sont déjà engagés aux côtés des démocraties et de nombreux citoyens américains combattent aux côtés de l'Entente.
 Alors que le traité de Brest-Litovsk sur le Front de l'Est permit aux Empires centraux de concentrer leurs forces sur un seul front et de disposer d'une supériorité numérique temporaire grâce à laquelle ils purent lancer des offensives importantes en France au printemps 1918, l'arrivée de l'American Expeditionary Force (AEF) sur le terrain fut l'une des clés de la victoire de la Triple-Entente. Lors de l'armistice, le 11 novembre 1918, environ 2 millions de soldats américains étaient en France, dont 1 million déjà engagé dans les combats. Deux autres millions étaient aux États-Unis dans les camps d'entraînement. Les plans prévus par Foch, Pétain et Pershing pour 1919 prévoyaient l'engagement de 4,5 millions de soldats américains dans les offensives de la victoire qui les mèneraient au cœur de l'Allemagne.
Alors que le traité de Brest-Litovsk sur le Front de l'Est permit aux Empires centraux de concentrer leurs forces sur un seul front et de disposer d'une supériorité numérique temporaire grâce à laquelle ils purent lancer des offensives importantes en France au printemps 1918, l'arrivée de l'American Expeditionary Force (AEF) sur le terrain fut l'une des clés de la victoire de la Triple-Entente. Lors de l'armistice, le 11 novembre 1918, environ 2 millions de soldats américains étaient en France, dont 1 million déjà engagé dans les combats. Deux autres millions étaient aux États-Unis dans les camps d'entraînement. Les plans prévus par Foch, Pétain et Pershing pour 1919 prévoyaient l'engagement de 4,5 millions de soldats américains dans les offensives de la victoire qui les mèneraient au cœur de l'Allemagne.
En 1776, les Etats-Unis ont été créé avec la volonté de tourner le dos à la Vieille-Europe, à ses guerres, à sa misère et à son arbitraire. Pourtant en 1917 les Américains s’engagent dans la guerre au côté des démocraties, pour le triomphe du droit et de la liberté, « to help finish the job » selon une expression courante en Amérique. L’idée est en effet de faire de l’Europe un continent démocratique et pacifié, qui au coté de l’Amérique éclairera l’humanité vers un monde meilleur.
 Dans le cadre de l’engagement américain sur le front français, l’interlocuteur de Pershing est le général Pétain. Commandant en chef les armées françaises du Nord et du Nord-Est. Pétain est l’homme qui a organisé la défense de Verdun, il connaît parfaitement ce secteur. Pour dégager Verdun et reprendre l’initiative il sait qu’il faut réduire le saillant de Saint-Mihiel et faire sauter le verrou allemand de l’Argonne. Il sait aussi, mieux que quiconque, que l’armée française est épuisée et qu’elle n’a plus les moyens humains et matériels de lancer ces offensives.
Dans le cadre de l’engagement américain sur le front français, l’interlocuteur de Pershing est le général Pétain. Commandant en chef les armées françaises du Nord et du Nord-Est. Pétain est l’homme qui a organisé la défense de Verdun, il connaît parfaitement ce secteur. Pour dégager Verdun et reprendre l’initiative il sait qu’il faut réduire le saillant de Saint-Mihiel et faire sauter le verrou allemand de l’Argonne. Il sait aussi, mieux que quiconque, que l’armée française est épuisée et qu’elle n’a plus les moyens humains et matériels de lancer ces offensives.
Pour les Américains ces offensives sont l’occasion de devenir les artisans de la victoire. Elles leurs  offrent la possibilité de gagner leurs lettres de noblesse sur des champs de bataille parmi les plus célèbres de la guerre, où tellement de sang a déjà coulé sans réussir à percer les lignes allemandes.
offrent la possibilité de gagner leurs lettres de noblesse sur des champs de bataille parmi les plus célèbres de la guerre, où tellement de sang a déjà coulé sans réussir à percer les lignes allemandes.
Dès le mois de septembre 1914, les Allemands avaient cherchés à prendre Verdun en tenaille par le Sud, le saillant de Saint-Mihiel s’était ainsi formé. C’est là que se trouvent la fameuse Crête des Éparges et la Tranchée de Calonne. Les soldats français et allemands y ont connu l’enfer et l’absurdité d’une stratégie du XIXe siècle où on pense emporter la décision en envoyant à la mort un plus grand nombre d’hommes que l’adversaire. Le mépris de la vie humaine a atteint un degré inimaginable dans cette guerre industrielle. Les Américains vont montrer que leurs méthodes sont plus efficaces pour emporter la décision.
 Après que la dernière grande offensive allemande ait, de mars à juillet 1918, cherché à percer le front en France, l'heure de la contre-attaque a sonné.
Après que la dernière grande offensive allemande ait, de mars à juillet 1918, cherché à percer le front en France, l'heure de la contre-attaque a sonné.
Celle-ci commence le 18 juillet, en direction de Fère-en-Tardenois : les alliés ont rassemblé 2’000 canons, toute l’aviation disponible et prés de 500 chars, réunis dans le plus grand secret au cœur de la forêt de Villers-Cotterêts. Totalement surpris, les Allemands refluent sous la pression. Une fois Château-Thierry reprise, la poussée devient générale et Ludendorff est contraint de revenir à son point de départ. Les Américains de Pershing apparaissent désormais en masse sur le front.
Le 8 août, 12 divisions britanniques et 15 françaises attaquent pour dégager la voie ferrée Paris-Amiens : les alliés progressent de 15 kilomètres et la panique s’empare des Allemands qui doivent retraiter en désordre. L’effet est catastrophique et Ludendorff, qui propose sa démission au Kaiser, parle de « jour de deuil de l’armée allemande », c'est la fin de l'espoir allemand d'une victoire.
Du 12 septembre 1918 au 15 septembre 1918, a lieu la première grande offensive des Américains
avec l'aide des Français. Elle a pour but la reprise du saillant de Saint-Mihiel, le site des Éparges est libéré, grâce à l’offensive de la Première armée américaine qui libère le saillant. Le 14 septembre 1918, les Américains sont à Fresnes-en-Woëvre : les Éparges ne sont plus aux mains des Allemands.
Dix jours plus tard, 500’000 Américains, 100’000 Français, 2’780 pièces d'artillerie, 380 chars et 840 avions s'engagent dans l'offensive Meuse-Argonne.
 Malgré de lourdes pertes, du 26 septembre au 10 novembre la progression victorieuse rejette les Allemands au nord du département de la Meuse. Cet engagement massif des Américains, près d'un million passent en Meuse, accélère la fin de la guerre. Ici, ils livrent la première grande bataille hors de leur pays.
Malgré de lourdes pertes, du 26 septembre au 10 novembre la progression victorieuse rejette les Allemands au nord du département de la Meuse. Cet engagement massif des Américains, près d'un million passent en Meuse, accélère la fin de la guerre. Ici, ils livrent la première grande bataille hors de leur pays.
Pour les Américains la conclusion du conflit par le Traité de Versailles amène une amère désillusion. L'impression que les vainqueurs européens de la guerre ne partagent pas les idéaux américains conduit le Congrès à rejeter le Traité de Versailles et à refuser l'entrée des États-Unis à la Société des Nations.
Les États-Unis, et notamment le président Wilson, veulent construire une Europe démocratique qui respecte « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » comme il l'indique dans son discours du 8 janvier 1918 où il présente en quatorze points son programme pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et reconstruire l'Europe.
Malgré l'investissement massif des États-Unis, les Américains n'ont pas réalisé leur objectif. L'Europe pacifiée ne commencera à voir le jour qu’après la Deuxième Guerre mondiale avec l'OTAN et ne deviendra finalement une réalité qu’après la chute du mur de Berlin et la libération de l'Europe de l'Est. Il faudra encore que l'Amérique consente d'énormes sacrifices pour que le continent européen connaisse la démocratie et la paix. La réunification de l’Europe a lieu après la chute du mur de Berlin en 1989, 71 ans après l’armistice de 1918.

Le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon, c'est celui où repose le plus grand nombre de militaires américains décédés en Europe au cours des deux guerres mondiales avec un total de 14 246 soldats enterrés dans cette nécropole.
Le monument de Montsec est érigé au sommet de la butte témoin qui domine le panorama des offensives menées par l'armée américaine sur le site de Saint-Mihiel (commune située à environ quinze kilomètres à l'ouest de Montsec) lors de la Première Guerre mondiale, du 12 au 15 septembre 1918 et du 9 au 11 novembre 1918.se veut aussi le symbole de la coopération entre armée française et américaine ayant permis la reconquête de Saint-Mihiel. Il a été érigé et est entretenu par l'American Battle Monuments Commission des États-Unis.